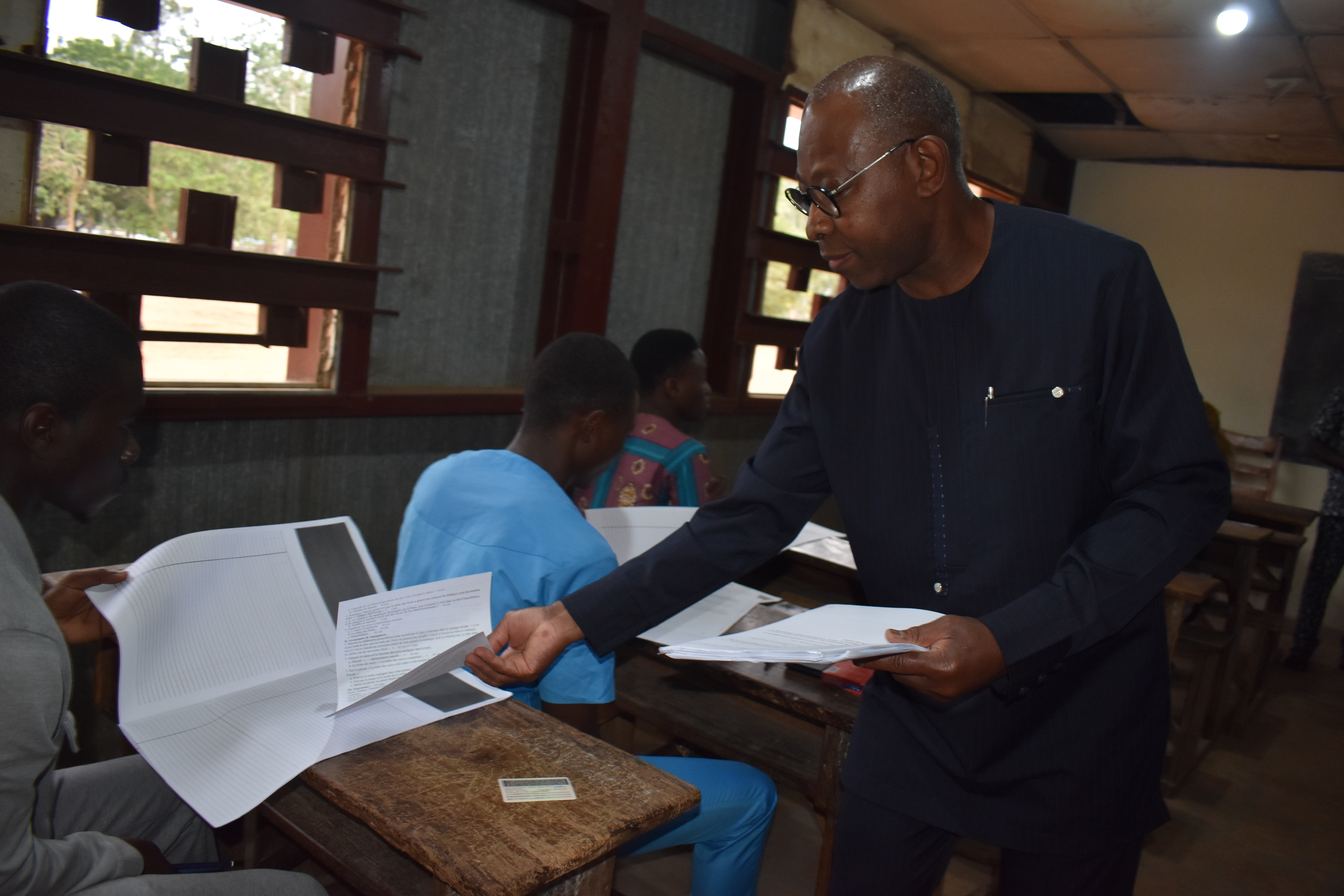À la veille de la rentrée parlementaire, l’Algérie s’apprête à ouvrir une session ordinaire qui marque le début d’une année 2026 jugée décisive, entre projets de lois majeurs et échéances électorales. Malgré les discours sur la vitalité démocratique, le Parlement reste largement encadré par la présidence, limitant la marge de manœuvre réelle des députés et sénateurs.
Le nouveau Premier ministre, Sifi Ghrieb, chargé de relancer l’économie, doit suivre une feuille de route prioritairement économique, tout en intégrant la dimension sociale. Les parlementaires, quant à eux, ont un rôle de contrepoids surtout symbolique, tant les grandes orientations sont verrouillées par l’exécutif.
Plusieurs projets de loi structurants sont annoncés, notamment sur les partis politiques et les codes communal et de wilaya, visant officiellement à responsabiliser les acteurs locaux. En pratique, ces réformes pourraient renforcer le contrôle de l’administration centrale et limiter l’autonomie des formations partisanes.
La rentrée parlementaire intervient également dans un contexte électoral : les partis non représentés promettent une opposition plus offensive, mais leur influence reste limitée face à un appareil d’État dominant. Par ailleurs, la limitation des mandats parlementaires à deux termes pousse à un renouvellement forcé des élus, sans garantir un véritable renouveau démocratique.
Enfin, la rhétorique sur la sécurité nationale et la « guerre de cinquième génération » justifie la prudence du régime et encadre toute contestation. La session illustre ainsi les difficultés à concilier ouverture institutionnelle et maintien du contrôle centralisé, confirmant les limites structurelles du système politique algérien malgré les promesses officielles.